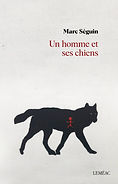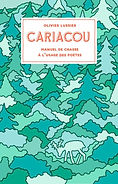Entre l'homme et la bête :
Éthique et esthétique dans le récit de chasse québécois contemporain (2000-présent)
Cette bande-annonce vous propose un aperçu d’une série d’entretiens réalisés entre novembre 2023 et avril 2024 et consacrés à la chasse dans la littérature québécoise contemporaine. Plus qu’un simple loisir ou une pratique traditionnelle, la chasse devient ici un lieu d’écriture, de mémoire et de réflexion sur l’identité, la transmission et notre rapport au vivant.
🎯 Pourquoi la chasse ?
Parce qu’elle raconte une histoire intime et collective. Elle traverse les générations, façonne les rapports de genre, met en jeu la relation entre humains et animaux, et devient une métaphore puissante pour interroger la mémoire, le langage et l’imaginaire. Les écrivain·e·s québécois·e·s que nous rencontrons ont chacun·e leur manière d’inscrire la chasse dans leurs récits : parfois comme un rite initiatique, parfois comme un héritage lourd à porter, parfois encore comme un espace de réinvention poétique.
✨ Dans cette série d’entretiens, vous entendrez :
-
Gabrielle Filteau-Chiba (Sauvagines, XYZ, 2019) : un roman où la chasse devient métaphore de la prédation, qu’elle soit faite aux animaux, aux femmes ou aux peuples autochtones. À travers Raphaëlle Robichaud, garde-chasse d’ascendance mi’kmaq ou malécite, l’autrice explore la colère, la justice et le renversement des rôles — de la proie à la prédatrice.
-
Mireille Gagné (Le lièvre d’Amérique, La Peuplade, 2020) : un roman fable où Diane, workaholic en quête de performance, subit une mystérieuse opération génétique qui la rapproche de l’animalité. Par la figure du lièvre – proie fragile, répétitive et menacée – l’autrice explore les rapports de prédation, qu’ils soient biologiques, sociaux ou professionnels.
-
Christian Guay-Poliquin (Les ombres filantes, La Peuplade, 2021) : un roman où le narrateur et le jeune Olio traversent une forêt dans un Québec marqué par de grands bouleversements et la disparition de l’électricité. La forêt devient un espace d’épreuves et de rencontres, où les bêtes, visibles ou imaginaires, incarnent la ruse et la puissance, et confrontent les personnages à leur propre instinct de survie.
-
Louis Hamelin (Les crépuscules de la Yellowstone, Boréal, 2020) : un roman centré sur la dernière expédition du naturaliste John James Audubon en 1843, qui, à 58 ans, explore l’Ouest américain pour observer et documenter la faune. Hamelin met en lumière le paradoxe d’Audubon : naturaliste et artiste, mais aussi chasseur, confronté à la violence et à la marchandisation des animaux.
-
Olivier Lussier (Cariacou. Manuel de chasse à l’usage des poètes, Les éditions de ta mère, 2023) : un livre hybride entre manuel, autofiction et poésie, où la chasse devient à la fois rituel d’initiation, mémoire familiale et critique des stéréotypes masculins.
-
Marc Séguin (La foi du braconnier, Leméac, 2009 ; Un homme et ses chiens, Leméac, 2022) : ses romans explorent la chasse comme pratique transgressive et comme révélateur de la nature humaine. Séguin s'interroge sur l’apprentissage, la transmission et la conscience morale dans l’acte de tuer, confrontant l’individu aux limites de la légalité et à ses propres valeurs.
📚 Pour aller plus loin :
La foi du braconnier (Leméac, 2009) de Marc Séguin
Sauvagines (XYZ, 2019) de Gabrielle Filteau-Chiba
Le lièvre d'Amérique (La Peuplade, 2020) de Mireille Gagné
Les crépuscules de la Yellowstone (Boréal, 2020) de Louis Hamelin
Les ombres filantes (La Peuplade, 2021) de Christian Guay-Poliquin
Un homme et ses chiens (Leméac, 2022) de Marc Séguin
Cariacou. Manuel de chasse à l’usage des poètes (Les éditions de ta mère, 2023) d'Olivier Lussier